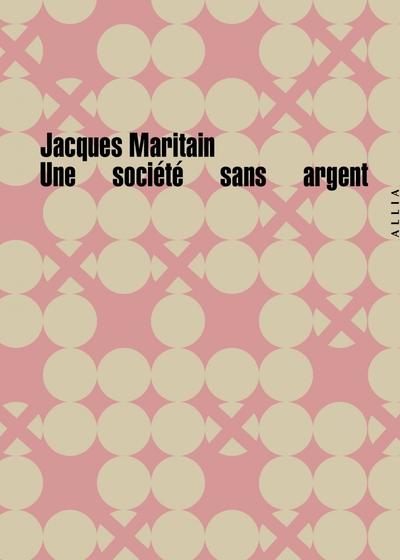
« Mieux vaut donc, au nom de la liberté, rester, tout en y cherchant des palliatifs, dans le régime capitaliste, malgré le vice originel qui le gâte dans l’ordre économique, le délabrement matérialiste qui y fait le malheur de notre civilisation, et la primauté de l’argent à laquelle toutes choses y sont de plus en plus soumises. Communisme, capitalisme, aucun de ces systèmes n’est bon ; et se résigner à opter pour le moindre mal est indigne de l’esprit humain. Une seule solution apparaît comme juste et bonne, c’est celle de la société sans argent. »
Comment inventer un monde sans argent ? À la fin de sa vie, Jacques Maritain tentait de répondre à cette question, qu’il considérait comme la plus cruciale pour nos sociétés.
Condamnant le prêt à intérêts, il estime contre nature un système soumis à la logique stérile du profit, au détriment du travail humain, seul créateur de richesses, et cherche à transformer le capitalisme.
Ainsi, il imagine un système de jetons se substituant à la monnaie, fabriqués et distribués par l’État. Dans cette société idéale, les citoyens exerceraient la profession de leur choix, à mi-temps, libres de jouir de leur temps sans aucune obligation, « sans qu’aucun contrôle à leur égard ne soit exercé ».
Jacques Maritain jetait ainsi les bases d’une utopie sociale qui permettrait à chacun d’accéder à une vie digne.
Philosophe engagé, théologien et diplomate, Jacques Maritain (1882-1973) est une figure majeure du thomisme au XXe siècle, qu’il réactualise face aux défis de la modernité. Élevé dans un milieu républicain et anticlérical, il se convertit très tôt au catholicisme avec son épouse Raïssa, femme de lettres et philosophe juive. Sous le signe de l’existentialisme, il découvre entre philosophie et doctrine chrétienne une complicité qu’il ne cessera de développer dans ses ouvrages et dans le cadre de son enseignement en France et aux États-Unis. Il est parmi les premiers à condamner le communisme et le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale. Prônant l’engagement des catholiques dans la démocratie, sa philosophie séduisit de nombreuses personnalités parmi lesquelles François Mauriac et Jean Cocteau. Longtemps méconnue, sa trace reste pourtant indélébile dans le paysage intellectuel français. Ses correspondances avec Paul Claudel, Georges Bernanos ou Edith Stein passèrent à la postérité, ainsi que ses liens avec d’autres grandes figures comme Charles Péguy, Henri Bergson et Léon Bloy.
