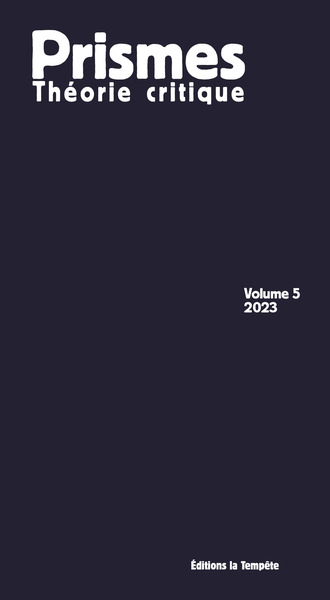
Alors que la « première génération » de la Théorie critique est aujourd’hui redécouverte en France avec enthousiasme, certains aspects de ses recherches restent encore peu explorés : c’est notamment le cas des travaux consacrés à l’antisémitisme.
Dans les années 1940, la « question antisémite » se trouve pourtant au centre des préoccupations de Theodor W. Adorno et de Max Horkheimer, alors exilés aux États-Unis : en témoignent les nombreuses études de cette période menées par l’Institut de recherche sociale sur les attitudes et discours anti-juifs ainsi que sur leurs déterminants socio-psychologiques, économiques, culturels, politiques, voire anthropologiques.
Non seulement ces travaux se révèlent décisifs pour comprendre l’évolution de la Théorie critique, mais ils ont aussi eu un impact majeur sur les recherches sur l’antisémitisme dans l’après-guerre, en Europe comme aux États-Unis.
SOMMAIRE :
- Bruno Quélennec , Agnès Grivaux, Léa Barbisan – « Présentation. Pour une théorie critique de l’antisémitisme contemporain »
- Otto Fenichel – « Éléments pour une théorie psychanalytique de l’antisémitisme »
- Ernst Simmel – « Antisémitisme et psychopathologie de masse »
- Theodor W. Adorno – « Pour combattre l’antisémitisme aujourd’hui »
- Léa Barbisan, Agnès Grivaux, Bruno Quélennec – « L’antisémitisme au prisme de la Théorie critique – la Théorie critique au prisme de l’antisémitisme »
- Bruno Quélennec – « Penser l’antisémitisme post-Auschwitz avec la « première » Théorie critique. Réceptions, apports, limites »
- Salima Naït Ahmed – « Constellations et intersections. Une approche de l’imbrication du genre et de l’antisémitisme à partir de la Théorie critique »
- Marc Crépon – « Le prix de la démocratie. Dans le prisme de la guerre »
